formation communication : la tyrannie de la note.
Je pose ici ma réflexion en tant qu’enseignant professionnel externe à l’université depuis plus de 20 ans, sur la formation inductive et le bien-être étudiant.
Formation communication : ou comment le système éducatif a oublié un élément essentiel, le bien être de l’élève / apprenant !
Au-delà de la note, comment retrouver l’essence de l’apprentissage ? curiosité et plaisir devraient être les moteurs de notre système
Après plus de vingt années d’enseignement à l’UCO d’Angers, à l’IAE de Rouen et à l’Université Paris V René Descartes PRES Sorbonne Paris Cité, j’ai acquis une conviction profonde : la note est moins importante que de donner envie à l’élève d’apprendre. Cette certitude, forgée par des milliers d’heures passées face à des étudiants, résonne étrangement avec les mots prémonitoires de Marc Bloch écrivant en 1943 sur les méfaits du « bachotage » (description ci-dessous dans mon paragraphe sur le piège du « réactif » devenu fin en soi.
Deux autres penseurs, un historien et un philosophe, expliquent aussi pourquoi notre système ne favorise pas cette curiosité et ce plaisir comme moteurs de l’apprentissage : la temporalité. Notre système veut que tout aille vite, or pour donner envie d’apprendre et pour avoir envie de creuser un sujet il faut du temps. Voici ce que nous enseigne Yuval Noah Harrari et Rosa Hartmut :
Si vous voulez creuser un sujet, il faut beaucoup de temps, et, notamment avoir le privilège de perdre son temps. Il faut pouvoir explorer des sentiers peu productifs, s’enfoncer dans des impasses, faire place aux doutes et à l’ennui, et laisser germer et s’épanouir de petites graines d’intuitions. Si vous ne pouvez vous permettre de perdre du temps, jamais vous ne découvrirez la vérité. [extrait du livre 21 leçons pour le XXIe siècle de Yuval Noah Harrari]
La théorie critique de l’accélération sociale du sociologue Hartmut Rosa explique que nous vivons dans une société à grande vitesse, poussée par des contraintes temporelles accrues, dans une réalité qui s’accélère si rapidement que nous ne pouvons pas suivre.
Prendre le temps de donner envie, plaisir et curiosité à un apprenant c’est peut-être plus long que de lui faire remplir un QCM ou réciter un texte d’un auteur par cœur mais c’est mon kiff. Alors je prends ce temps. Je comprends qu’un cours puisse avoir une temporalité (1h ou 2h). Dans ce temps j’aime a demander à l’élève ses expériences en communication, son vécu ou ce qu’il accepte de partager sur sa vision de la marque. Comme j’aime les inviter à partager le « bâton de parole » en fin de séance, pour recueillir ce qu’ils ont apprécié ou ce que je peux améliorer durant l’échange que nous avons eu durant cette temporalité. Je pense qu’il y a sûrement un juste milieu entre un programme à boucler pour satisfaire les attendus de l’éducation nationale et susciter la curiosité et l’ouverture de l’apprenant.
Le piège du « réactif » devenu fin en soi
Marc Bloch critique explicitement la transformation de la note scolaire, censée être un simple « réactif » (un outil d’évaluation), en une fin en soi, orientant tout le système éducatif vers la préparation à l’examen plutôt que vers la curiosité et le plaisir d’apprendre. Ce renversement est au cœur de ses réflexions, particulièrement dans son texte « Sur la réforme de l’enseignement » (1943).
Extrait de Marc Bloch sur la note et le bachotage
« …La crainte de toute initiative, chez les maîtres comme chez les élèves ; la négation de toute libre curiosité ; le culte du succès substitué au goût de la connaissance… Un mot, un affreux mot, résume une des tares les plus pernicieuses de notre système actuel : celui de bachotage. (…) L’enseignement secondaire, celui des universités et les grandes écoles en sont tout infectés.
‘Bachotage’. Autrement dit : hantise de l’examen et du classement. Pis encore : ce qui devait être simplement un réactif, destiné à éprouver la valeur de l’éducation, devient une fin en soi, vers laquelle s’oriente, dorénavant, l’éducation tout entière. On n’invite plus les enfants ou les étudiants à acquérir les connaissances dont l’examen permettra, tant bien que mal, d’apprécier la solidité. C’est à se préparer à l’examen qu’on les convie. »
Bernard Lahire critique lui aussi vivement le système de notation à l’école française, qu’il accuse de détourner l’éducation de son objectif initial – transmettre des connaissances et susciter la curiosité. Dans son livre tout récent, « Savoir ou périr » (Seuil, août 2025), il affirme :
«Comment ne pas voir que tout ce cirque de la préparation des contrôles, des examens, des concours n’a strictement rien à voir avec la qualité des apprentissages, la profondeur des compréhensions et la curiosité à découvrir des choses nouvelles ?»
Cela sert un système : l’université qui se glorifie de son taux de réussite. Cela alimente des bases de données pour classer les pays qui ont des bons élèves et les écoles entre elles. Bernard Lahire, d’ajouter la « terreur » vécue par l’enfant face à la peur des contrôles, des fautes, des mauvaises notes, et du jugement scolaire :
«La terreur, c’est celle de l’enfant qui a peur des contrôles, peur de faire des fautes, peur des mauvaises notes, peur du jugement scolaire et de la réaction de ses parents. La peur ne prédispose pas à comprendre et à apprendre. L’obsession évaluative a détourné l’école de sa fonction de transmission des connaissances. L’institution scolaire fonctionne comme une machine à évaluer, à classer et à trier, et comme par définition seule une minorité d’élèves parviennent au sommet des classements, la majorité des élèves sont maltraités. Même les meilleurs vivent parfois dans la crainte de perdre leur place.»
Lahire insiste sur la nécessité de « retrouver le plaisir du savoir » et sur le fait que le système éducatif « tourne à l’envers » : « programmes surchargés, pilotage par l’évaluation, bachotage… Notre système scolaire ‘fonctionne à l’envers’ et détruit la curiosité des enfants »

Quatre-vingts ans plus tard, je constate que nous n’avons pas suffisamment tiré les leçons de ces analyses. Dans mes cours de communication inductive en à l’université, je vois encore trop d’étudiant.e.s me demander : « Professeur, est-ce que cela tombera à l’examen ? » plutôt que : « Professeur, comment puis-je utiliser cela dans ma future vie professionnelle ? » C’est véritablement un élément fondamental pour moi. Quand je transmet un concept ou une une idée, à un apprenant c’est pour qu’il gagne confiance en lui. Pour planter la graine de l’appétence pour ce sujet, qu’il s’agisse de stratégie de communication, de webmarketing, de SEO, de design graphique et PAO... L’objectif est bien que dans ses stages, dans son taff demain il puisse mettre en œuvre plus facilement le concept. Qu’il ait du sens pour passer à l’action.
Cette obsession de la notation génère ce que Bloch appelait « la crainte de toute initiative, chez les maîtres comme chez les élèves ; la négation de toute libre curiosité ». J’ai choisi de prendre le contre-pied de cette approche en développant une pédagogie inductive qui place l’épanouissement de l’étudiant au cœur de ma démarche. De mon point de vue le système marche sur la tête. Alors plutôt que de prendre du Guronsan, j’essaye de faire grandir mes élèves.
Lire les témoignages de : Nora en stage de communication à l’agence, d’Alexandre étudiant en 2e année d’une école de digital ou Myriam en stage découverte.
La formation inductive : faire grandir plutôt que formater
Ma méthode d’enseignement s’appuie sur trois piliers fondamentaux :
La curiosité comme moteur d’apprentissage : Plutôt que d’assommer mes étudiants avec des théories abstraites, je pars de leurs questions, de leurs expériences, de leurs projets. En communication d’entreprise, par exemple, je les invite à analyser des situations concrètes qu’ils ont vécues en stage ou qu’ils observent dans l’actualité ou auprès de leurs proches. Cette approche de l’apprenant vers le formateur (bottom-up) permet de créer du sens avant d’introduire les concepts théoriques.
La confiance en soi comme préalable à l’expertise : Je refuse de considérer mes étudiants comme des « récipients vides » à remplir. Chacun arrive avec un bagage, des expériences, une personnalité unique. Par exemple dans mon cours sur la communication de marque à l’UCO, chacun a son regard sur la marque, sa pratique, et apporte l’exemple d’un influenceur qu’il adore, ou d’une boutique bio où il/elle aime bien se rendre parce que cela correspond à ses valeurs. Mon rôle n’est pas de les formater mais de révéler leurs potentiels. Quand un étudiant introverti découvre qu’il excelle dans la communication écrite ou digitale, quand une étudiante timide réalise sa capacité à mener des entretiens individuels, alors l’apprentissage devient transformateur.
L’erreur comme alliée de l’apprentissage : Dans mes cours, l’erreur n’est pas sanctionnée mais explorée. Comme le souligne si justement Charles Pépin dans son livre « les vertus de l’échec ». L’erreur est constitutive de l’apprentissage. Alors je pose l’exercice, les consignes, les élèves me présentent un premier projet. je commente avec bienveillance pour éclairer sur les points qui me semblent encore incompris. Ils rebossent le sujet. Me le présentent une 2e fois. Et suite à mes nouveaux commentaires ils repartent de mon cours avec une meilleure compréhension du sujet. L’erreur devient une opportunité de compréhension approfondie. Cette philosophie libère les étudiants de la peur de se tromper et ouvre l’espace à la créativité et à l’innovation.
L’IA et la curiosité : un nouveau défi pédagogique
L’émergence de l’intelligence artificielle dans l’éducation renforce ma conviction que la curiosité doit primer sur la notation. Face à ChatGPT et autres outils d’IA, que vaut une évaluation basée sur la restitution de connaissances ? L’enjeu n’est plus de mémoriser mais de savoir poser les bonnes questions, d’exercer son esprit critique, de développer sa créativité.
En communication d’entreprise, j’encourage désormais mes étudiants à collaborer avec l’IA pour explorer des stratégies de communication innovantes. L’objectif n’est pas de reproduire ce que l’IA propose mais de la questionner, de l’enrichir, de la personnaliser. je les invite à utiliser Perplexity, Claude, ou Mistral… Cette approche collaborative développe leur capacité d’analyse et leur esprit critique bien mieux qu’un QCM traditionnel.
L’IA devient alors un révélateur de curiosité : celui qui pose des questions pertinentes, qui reformule, qui creuse, qui expérimente, développe des compétences bien plus précieuses que celui qui se contente de noter la première réponse obtenue.

ORGANISEZ AUX MIEUX VOTRE APPRENTISSAGE OU
PERFECTIONNEZ VOTRE EXPERTISE AVEC NOTRE FORMATION STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Contre le conformisme éducatif : libérer les voies d’épanouissement
Les mots du professeur Keating (incarné par l’acteur Robin Williams) dans « Le Cercle des Poètes Disparus » résonnent puissamment dans ma pratique pédagogique.
Quand il encourage ses élèves à « saisir le jour », à penser par eux-mêmes, à trouver leur propre voix, il incarne cette résistance nécessaire face à un système qui contraint l’élève à suivre une voie qui n’est pas forcément la sienne.
J’ai vu trop d’étudiants brillants s’éteindre dans des cursus qui ne leur correspondaient pas, simplement parce qu’ils avaient « de bonnes notes ». J’ai vu à l’inverse des étudiants considérés comme « moyens » s’épanouir dès qu’ils trouvaient leur domaine de prédilection. La substantifique moelle de l’apprentissage inductif, c’est précisément cela : faire grandir l’élève en révélant ses talents uniques plutôt que de le couler dans un moule préétabli. Notre société « formate » l’apprenant mais ne l’ouvre pas à la curiosité du monde et à l’esprit critique.
formation communication : L’urgence du bien-être étudiant
L’Éducation Nationale et le système universitaire ont, à mon sens, oublié l’essentiel : le bien-être de l’élève. Nous avons construit des machines à diplômes efficaces mais avons-nous créé des humains épanouis, critiques, créatifs ?
Mes vingt années d’enseignement m’ont convaincu que la performance académique et le bien-être ne s’opposent pas, bien au contraire. Un étudiant qui trouve du plaisir dans l’apprentissage, qui développe sa confiance en lui, qui nourrit sa curiosité naturelle, obtient des résultats durables et transférables.
Il est temps de remettre l’humain au cœur de nos préoccupations pédagogiques. Non pas par angélisme, mais par efficacité. Car au final, qu’est-ce qui compte le plus : former des étudiants capables de réciter parfaitement leurs cours ou développer des individus autonomes, créatifs et épanouis ?
Des alternatives inspirantes : ce que nous enseigne l’étranger
Il serait peut-être judicieux de jeter un coup d’oeil à l’international. En Europe dans d’autres pays il y a des pratiques alternatives fascinantes. En Finlande, par exemple, les évaluations chiffrées n’apparaissent qu’à partir de 13 ans. Avant cela, les enseignants privilégient les retours qualitatifs, les portfolios de progression et l’auto-évaluation. Le résultat ? Une des populations les plus performantes au monde selon PISA, mais surtout des élèves qui conservent leur plaisir d’apprendre.
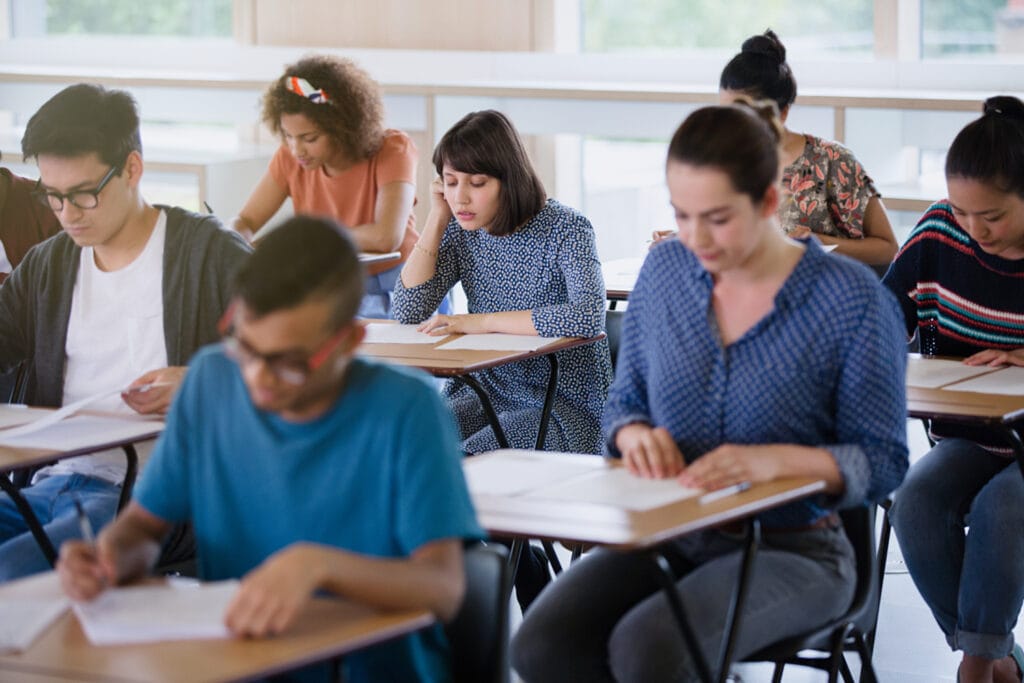
Au Danemark, le système d’évaluation par compétences remplace progressivement les notes traditionnelles. Les étudiants sont évalués sur leur capacité à mobiliser leurs connaissances dans des situations concrètes plutôt que sur leur capacité à restituer des savoirs décontextualisés. Cette approche rejoint parfaitement ma pratique en communication d’entreprise où j’évalue mes étudiants sur des projets réels plutôt que sur des partiels théoriques.
L’Allemagne, avec son système d’apprentissage dual, démontre l’efficacité d’une évaluation continue intégrée au processus d’apprentissage. Les apprentis sont évalués sur leur progression, leur capacité d’adaptation et leur évolution personnelle autant que sur leurs performances techniques.
Ces exemples me confortent dans l’idée que nous pourrions, en France, expérimenter des approches similaires. Imaginez des étudiants évalués sur des portfolios de projets, des présentations orales, des créations collaboratives, des résolutions de problèmes réels d’entreprises… Cette approche développerait leur confiance, leur créativité et leur employabilité bien mieux que nos traditionnelles batteries de contrôles continus.
Conclusion : pour une révolution douce de l’éducation
Ma conviction, forgée par des années d’expérience en formation inductive, rejoint les intuitions de Marc Bloch : nous devons redonner à l’éducation sa finalité première, qui n’est ni la note ni le classement, mais l’épanouissement de l’intelligence et de la personnalité.
Cette révolution ne nécessite pas de bouleverser tout le système d’un coup. Elle commence par des gestes simples : valoriser une question pertinente plutôt qu’une réponse parfaite, encourager l’expérimentation plutôt que la reproduction, cultiver la confiance plutôt que la peur de l’erreur.
C’est cette approche que je continuerai à défendre et à pratiquer, car je suis persuadé que l’avenir appartient à ceux qui sauront apprendre tout au long de leur vie, et non à ceux qui auront simplement su obtenir de bonnes notes à un instant donné.
Le visuel de couverture (Crédit image photo de couverture adobe adobe firefly – retouche et montage Photoshop Desjeux Créations – photo étudiant et notation adobe stock) illustre l’apprenant androgyne qui s’épanouit, au-delà de la notation. Le jaune symbole des émotions positives. Signe de rayonnement, d’optimisme, d’illumination, de sagesse et de clarté d’esprit. Autant d’éléments qui invitent l’apprenant à prendre le temps de trouver son plaisir dans la découverte d’une matière. L’enseignant tel un passeur présent pour le faire grandir et lui entrouvrir le chemin de la curiosité et de l’envie d’aller plus loin sur ce chemin de l’apprentissage.
Plus de 30 ans d’expérience en communication d’entreprise et de marque
Alexis Desjeux, responsable pédagogique de l’agence Desjeux Créations, enseigne à l’université et forme des professionnels de la communication depuis plus de 20 ans.
Label et certification de formation. Notre organisme de formation est référencé sur Datadock (numéro de référence 0043212) et CERTIFIÉ QUALIOPI N° de certificat FR059137-1 (catégorie L6313-1 actions de formation). L’ensemble de nos formations ont été enregistrées auprès du préfet de région de Pays de la Loire (numéro 52 49 02492 49). La prise en charge financière de nos formations est possible via votre Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA / OPCO).
Formation communication dans différents domaines (stratégie de communication, design graphique, webmarketing, management) proche Angers –Beaufort en anjou – Brissac-Quincé (commune déléguée de Brissac Loire Aubance) – Saumur – Doué en Anjou (anciennement Doué-la-Fontaine) – les Alleuds – Juigné sur loire – Mur Erigné (49 Maine-et-Loire).